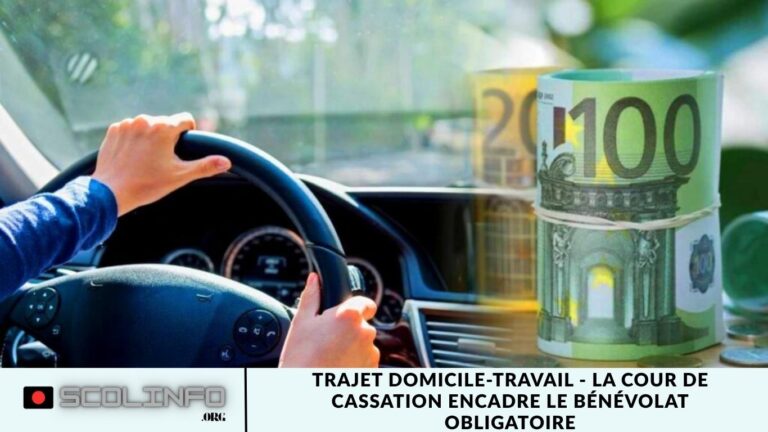Ils parlent de « la fin du bénévolat pour aller travailler ». Cette expression, partagée avec une pointe de lassitude et d’espoir par Pascal Rouillon, technicien de maintenance dans les Hauts-de-France, reflète le ressenti d’une part croissante des salariés mobiles. Un arrêt récent de la Cour de Cassation marque un tournant attendu, avec des conséquences potentielles importantes pour une catégorie de travailleurs longtemps ignorée dans les débats sur le temps de travail.
Une décision attendue par les salariés itinérants
Le 1er octobre 2025, un arrêt discret de la Cour de Cassation est venu confirmer un principe établi en 2022 et renforcé en janvier 2025 : les trajets domicile-clients peuvent, sous certaines conditions, être considérés comme du temps de travail effectif. Cette évolution de la jurisprudence ne signifie pas une rémunération automatique pour tous, mais concerne spécifiquement les salariés itinérants, ces professionnels dont le véhicule sert parfois de seconde salle de réunion.
Des critères stricts pour un changement limité
Le droit français reste clair : selon l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de trajet vers le lieu d’exécution du contrat n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Cependant, une exception introduite, en cohérence avec une directive européenne et un arrêt de la CJUE de 2015, modifie la donne pour certains profils : techniciens, commerciaux ou livreurs de haut niveau.
Pour que le trajet soit reconnu comme du temps de travail, trois conditions cumulatives doivent être respectées :
- Le salarié doit être à la disposition de l’employeur.
- Il doit suivre les directives de l’employeur.
- Il ne doit pas pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Une lecture attentive de ces critères montre pourquoi l’impact reste limité en nombre de bénéficiaires, tout en étant profond pour ceux concernés.
Un cas emblématique : téléphone en main, volant comme bureau
C’est l’histoire de Pascal Rouillon, technicien itinérant dans une entreprise de maintenance industrielle. Chaque matin, dès 6h45, il prend sa voiture de service pour rejoindre son premier client. En chemin, il appelle l’assistant logistique, suit les directives du planning, échange avec son chef d’équipe, et doit parfois changer de destination à la dernière minute.
« Je n’ai pas un moment tranquille dans la voiture. Je suis en contrôle permanent, obligé d’enchaîner les consignes. Et à la fin du mois, aucune heure comptée. C’est insupportable », confie Pascal. « Cela fait 14 ans que je travaille ainsi. J’ai calculé : plus de 1 000 heures gratuites juste pour aller d’un point A à un point B. Mon travail ne tiendrait pas sans ça. »
Pour lui, les trois critères légaux sont clairement remplis. Un jugement de novembre 2022 avait déjà statué sur une situation similaire : le salarié utilisait son téléphone en conduisant pour suivre des instructions en temps réel. La Cour avait alors précisé que ces trajets devaient être intégrés au temps de travail effectif, un principe consolidé début 2025 et confirmé à nouveau le 1er octobre.
En savoir plus: Retraite d’une Caissière Après 39 Ans de Service à 1900€ par Mois – Montant Réel Aujourd’hui
Les obligations des employeurs évoluent
Ce changement impose une vigilance accrue aux entreprises. La charge de prouver si les conditions légales sont remplies ou non repose désormais sur les juridictions prud’homales. Plusieurs affaires sont déjà en cours, avec des revendications allant du rappel de salaires sur cinq ans aux heures supplémentaires majorées, voire à la requalification de contrats.
Dès que les trajets dépassent le temps standard domicile-travail sans être considérés comme du temps de travail effectif, une compensation devient obligatoire. Celle-ci peut prendre la forme d’un versement financier ou de repos compensatoire, une subtilité encore méconnue de nombreux employeurs.
| Situation | Statut juridique | Conséquence |
|---|---|---|
| Trajet domicile–lieu de travail habituel | Non considéré comme temps de travail effectif | Pas de rémunération obligatoire |
| Trajet domicile–client (sous directives et contraintes) | Considéré comme temps de travail effectif (si critères remplis) | Rémunération obligatoire |
| Trajet long dépassant le temps normal sans directives | Non considéré comme temps de travail effectif | Compensation obligatoire (financière ou repos) |
Une portée réelle mais ciblée
Contrairement au bruit circulant sur les réseaux sociaux, cette décision ne concerne pas les millions de salariés qui se rendent quotidiennement à leur bureau ou à leur commerce. Les trajets domicile–travail classiques ne seront pas automatiquement inclus dans le temps de travail.
En revanche, pour une partie estimée à près de 1,1 million de salariés itinérants selon l’INSEE, cette évolution représente une véritable opportunité. Les prud’hommes seront bientôt sollicités pour trancher les premières affaires, tandis que plusieurs syndicats appellent déjà à la renégociation de certains accords collectifs.
Un impact structurel sur les ressources humaines ?
Face à cette évolution, les DRH révisent leurs grilles de compensation. Certaines grandes entreprises du BTP et des services techniques ont déjà intégré des clauses de majoration pour les temps de trajet utilisés à des fins professionnelles. D’autres restent prudentes, craignant de créer des précédents financiers lourds.
« Ce qui nous inquiète, ce ne sont pas quelques trajets isolés, mais l’effet domino. Si un salarié prouve que ses années de déplacements relèvent du temps de travail effectif, le passif financier peut devenir énorme. La direction n’en avait pas mesuré l’ampleur », confie un cadre RH sous couvert d’anonymat.
Pour l’instant, les décisions restent examinées au cas par cas. Mais le cadre légal évolue, et avec lui, l’équilibre jusque-là discret sur lequel reposait le travail mobile en France.
FAQ
Qu’entend-on par « bénévolat obligatoire » pour le trajet domicile-travail ?
Le « bénévolat obligatoire » désigne le temps de trajet effectué par certains salariés sans rémunération, alors qu’ils restent sous les directives de leur employeur. La Cour de Cassation vient encadrer cette pratique pour les salariés itinérants.
Quels salariés sont concernés par cette décision ?
Principalement les salariés itinérants : techniciens, commerciaux, livreurs ou tout professionnel dont le véhicule sert de prolongement du lieu de travail. Les trajets domicile–bureau classiques ne sont pas concernés.
Cette décision s’applique-t-elle à tous les trajets domicile-travail ?
Non. Elle ne concerne pas les trajets quotidiens vers le bureau ou le commerce habituel. Elle s’applique uniquement aux trajets réalisés sous directives et contraintes professionnelles.
Quelles sont les conséquences pour les entreprises ?
Les entreprises doivent revoir leurs grilles de compensation, car la charge de preuve repose désormais sur les juridictions prud’homales. Certaines clauses de majoration des temps mobiles peuvent être intégrées pour éviter des litiges futurs.
Quel type de compensation peut être exigé ?
La compensation peut être financière (rémunération des heures de trajet) ou sous forme de repos compensatoire.
Depuis quand cette jurisprudence est-elle en vigueur ?
Le principe a été posé en 2022, renforcé en janvier 2025 et confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation le 1er octobre 2025.
Les syndicats se mobilisent-ils à ce sujet ?
Oui, plusieurs syndicats appellent déjà à la renégociation des accords collectifs pour intégrer cette nouvelle règle et protéger les salariés itinérants.
Conclusion
La récente décision de la Cour de Cassation marque un tournant significatif pour le monde du travail mobile en France. En encadrant le « bénévolat obligatoire » des trajets domicile–client, elle offre une protection accrue aux salariés itinérants tout en imposant une vigilance nouvelle aux employeurs. Si l’impact immédiat reste limité à certains profils, les conséquences financières et juridiques pourraient être majeures à long terme. Entre prudence des DRH, actions syndicales et premières saisines des prud’hommes, ce changement illustre combien le temps de trajet peut désormais être reconnu comme un véritable temps de travail effectif.